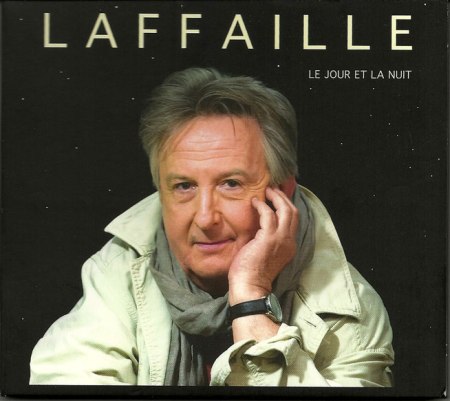Robert Léger est membre de Beau Dommage. En octobre 2010, il s’exprimait avec courage et humour dans les colonnes du webzine Vapeur Mauve sur l’histoire de la musique et de son groupe, la critique, etc. J’avais co-piloté cet entretien, qu’il me semble pertinent de republier ici aujourd’hui. C’est un peu long, mais vous n’êtes pas obligés de le lire d’un seul souffle!
Tout simplement jaloux (de Beau Dommage)
La scène musicale québécoise foisonnait dans les années 70. Longue était la liste des groupes de cette période qui nous ont laissé au moins un disque en héritage. Toutefois, aujourd’hui, la grande majorité d’entre eux est tombée dans l’oubli, d’autres n’intéressent que les mélomanes passionnés par la musique de cette décennie. De cette multitude de formations, seules deux ont su réellement se démarquer par une œuvre riche et intemporelle, à tel point qu’en 2010 encore, on peut entendre régulièrement leurs chansons sur les ondes des radios québécoises : Harmonium et Beau Dommage. Deux groupes également dont les noms viendront instinctivement à l’esprit des francophones européens lorsqu’on leur demandera ce qu’ils retiennent de cette décennie venant de la Belle Province. Robert Léger, claviériste et flûtiste de Beau Dommage, auteur entre autres de Tous les palmiers, Harmonie de soir à Châteauguay, Amène pas ta gang ou la superbe J’ai oublié le jour, a accepté de nous accorder une entrevue pour nous parler de son groupe, mais également pour nous apporter un éclairage précieux sur ce qu’était cette scène musicale-là. Écoutons-le.
Vapeur Mauve : On vous a posé parfois la question, mais les lecteurs de Vapeur Mauve aimeraient une réponse très sincère: existait-il une compétition entre les artistes dans les années 70 au Québec ? Est-ce que la camaraderie ambiante, apparente, cachait des jalousies, voire du mépris ? On veut des noms.
Robert Léger : La compétition n’était pas très virulente. L’époque était réellement imbibée de ces valeurs de soutien, partage, entraide. Cependant, on ne peut heureusement éradiquer ces dynamiques émotions qu’est, par exemple, la jalousie. Beau Dommage ne se sentait pas jaloux d’autres groupes ou artistes car, bien que modestes, nous sentions bien que notre situation était privilégiée (accueil du public, ventes de disques. etc.) Mais on sentait la jalousie à notre égard se pointer parfois. Je me souviens d’une entrevue où un membre de Conventum ne s’expliquait pas notre succès, je le cite texto : « Ils sont tellement poches musicalement, comment se fait-il que ça pogne ? »
VM : Lorsque Harmonium sortait ses disques, est-ce que les membres de Beau Dommage en discutaient entre eux ? Saine compétition ?
Robert : Nous avions réellement un grand respect pour Harmonium. On admirait leur musique. Pour les textes, on était moins convaincus, un peu désorientés par l’hermétisme du propos…
VM : Plusieurs artistes des années 70 collaboraient entre eux, mais Beau Dommage n’a pas, à notre connaissance, fait appel à de l’aide extérieure. Pourquoi ?
Robert : Pour le genre de chansons que l’on faisait, un folk-rock assez simple musicalement, nous pouvions fort bien nous suffire à nous-mêmes. De plus, on ne composait pas des pièces d’envergure exigeant des collaborations extérieures pour exister. Cependant, quand le besoin s’en faisait sentir, on utilisait des musiciens de studio extérieurs au groupe. Voir les crédits pour certaines chansons sur Où est passée la noce ?
VM : Votre morceau épique et plus directement progressif est Un incident à Bois-des-Filion. Il paraît qu’il était déjà composé avant la sortie de votre premier album en 1974. Pourquoi avoir attendu la sortie de votre second disque pour l’enregistrer ?
Robert : TRÈS TRÈS PARADOXALEMENT, la compagnie Capitol EMI voulait inclure ce morceau sur notre premier album, car son directeur artistique montréalais, Pierre Dubord, avait été d’abord séduit par cette pièce qui s’apparentait aux musiques progressives britanniques. C’EST NOUS qui avons refusé… préférant d’abord nous faire connaître avec des chansons qui nous ressemblaient plus, plus fidèles à notre esthétique d’apologie du quotidien, plus « small is beautiful ».
VM : Et pourquoi ne pas avoir poursuivi dans cette voie ? Un incident à Bois-des-Filion semble être un bel ovni dans votre répertoire qui n’est généralement pas relié au rock progressif.
Robert : La réponse est dans la question… Pour nous, c’est une expérience hors de nos goûts réels. D’une part, on ne s’est pas dit : « faisons de la musique progressive… », on a reçu de Pierre Huet ce long texte et on l’a mis en musique comme on le ferait pour une chanson normale. Notre but était de créer une longue chanson. Point. Chemin faisant, pour relier les parties du texte, on a composé des ponts, des transitions et on s’est retrouvé avec une œuvre qui pouvait se classer dans la musique progressive, mais ce n’était pas vraiment notre intention de départ.
VM : Pourquoi ne pas avoir poursuivi dans cette direction ?
Robert : C’est un peu mal nous connaître que de poser la question. Nous partagions entre nous un amour pour la chanson de format traditionnel de 3-4 minutes. C’est cette forme d’expression qui nous allumait, c’est cette contrainte qui nous inspirait. Je donnerais personnellement tout Yes, Genesis, Jethro Tull et cie pour L’orage de Georges Brassens. La musique progressive, pour moi, n’est pas un « progrès », n’est pas une libération souhaitable hors des pauvres limites de la chanson. C’est une forme de musique qui a donné des beaux résultats souvent, mais ceux qui célèbrent ce type de musique comme étant l’âge d’or de la chanson n’ont jamais réellement apprécié ce qui fait le charme concis, discret et subtil d’une chanson. Ce sont des mélomanes qui recherchent d’abord l’expérimentation musicale, l’éclatement des formes et qui doivent être bien déçus de n’avoir à se mettre sous la dent que les éternelles chansons de 4 minutes avec les contraintes imposées par le genre. Je pense à Alain Brunet (NDLR journaliste au quotidien La Presse) qui n’aurait jamais dû être payé pour évaluer des chansons… Pour lui, c’est un sous-genre qui ne soulève son intérêt qu’à la mesure des libertés qu’elle ose prendre… Point de vue bien regrettable !
VM : Pierre Foglia, chroniqueur à La Presse, écrivait en 1976 : « Je sens que je suis en train d’écrire comme Harmonium joue : pour plaire, pour me trouver des fans dans les cégeps ! Finalement, le modèle idéal, ce serait Conventum, c’est-à-dire broder à partir d’un beat connu. Ne pas prétendre réinventer la musique, lui donner seulement une couleur différente. Tant pis si ça claque un peu trop fort du côté des drums, les soirs où Mathieu Léger a beaucoup soif, ses percussions restent quand même inventives, et les claviers de Charlot, comme la guitare de Duchesne ont tout autant d’imagination. Il y a chez Conventum ce fond de jazz que les autres ont renié. Ne cherche pas dans la pile de disques, Lili, je n’ai pas de long jeu de Conventum. Ils n’en ont pas encore gravé et ne semblent pas pressés de le faire… »
Robert : Les appréciations musicales de Foglia m’ont toujours fait sourire. Autant le chroniqueur est doué, autant ses goûts musicaux sont ceux d’un baba cool franchouillard qui ne voit d’abord dans la musique qu’un pied de nez aux valeurs bourgeoises. Ses goûts en littérature sont solides, cohérents, ses jugements la plupart du temps fort justes (en bon artisan, il connait son métier), mais dans ses analyses musicales, je l’ai toujours perçu comme un regrettable Papy-fait-du-rock. Comme ces premiers journalistes français commentant le rock (et Petrowski est de cette école) et qui écrivaient des trucs du genre: « Les guitares de la révolte déchiraient la nuit dans la stridence des Stratocasters ». Oh comme ce genre d’écrit faisait rigoler ceux qui précisément jouaient ces « guitares de la révolte »…
VM : Est-ce que vous trouvez que certains artistes, même de la trempe d’Harmonium, même «contre-culturels», se souciaient trop de plaire à un certain public et que la musique en général n’était pas assez spontanée ? Les années 70 étaient-elles réellement dénuées de toute préoccupation commerciale ? Est-ce que Beau Dommage se faisait taxer de groupe populaire, avec du mépris dans la voix ?
Robert : Franchement, je dois dire que ces questions de préoccupations commerciales n’étaient pas à l’avant-plan. La musique était très peu organisée de façon industrielle comme elle l’est aujourd’hui. Les notions de succès commercial, de ventes, étaient assez secondaires pour la majorité des artistes de ma gang. Nous étions jeunes et ne pensions pas beaucoup à ces choses. Ça ne veut pas dire que nous étions des saints, des purs. Peu importe l’époque, l’être humain a un vieux fonds égocentrique et peut facilement faire passer son intérêt personnel avant celui de la collectivité, mais dans ce temps-là, ce qui nous valorisait n’était pas les succès commerciaux, mais l’image d’intégrité artistique que l’on pouvait dégager. Comprenez-moi bien : demeure toujours le souci de l’image que l’on projette. Si, aujourd’hui, afficher 100 000 copies vendues te donne une bonne image, ce n’était pas le cas dans les années 70… Beau Dommage évidemment se faisait accuser de vouloir faire du fric et de planifier soigneusement ses succès commerciaux. Ce n’était pas le cas.
VM : Que pensez-vous des artistes de prog ou de free-jazz québécois ? Les Contraction, Conventum, Yves Laferrière, Toubabou, tous ces artistes tirés de l’oubli par l’étiquette Prog Québec ?
Robert : Faudrait que je réécoute, ce serait plus honnête plutôt que d’y aller au feeling… Le souvenir que j’en garde en est de gens talentueux et intègres qui faisaient une recherche musicale avec des réussites et des passages plus ennuyeux. La distinction que j’apporterais est la suivante : leur démarche n’était pas axée beaucoup vers le format « chanson », mais plutôt visait à développer des nouvelles avenues MUSICALEMENT… Ce n’est pas exactement la même chose. L’équilibre texte/musique essentiel à une bonne chanson était négligé au profit de la musique. Je rappelle la formule de Denis Farmer, batteur mythique de cette époque, pour évoquer son travail de musicien : « on va aller brasser des sons ! »
VM : Est-ce que Beau Dommage sentait faire partie de ce courant ? Ou d’un autre ?
Robert : On faisait des chansons. On se sentait plus proche de Félix Leclerc que de Contraction. Mais dans nos arrangements, on tenait compte de ces avenues débroussaillées par d’autres plus aventureux.
VM : À part quelques rares exceptions (comme Roger Rodier, Sex ou Mathieu), la musique québécoise des années 70 se chantait exclusivement en français. Était-ce par choix ou pensez-vous que certains groupes auraient souhaité chanter en anglais, mais craignaient la réaction du public ?
Robert : Se souvenir que nous sommes en pleine montée du sentiment nationaliste. Pour être « in », on chante en français, plus précisément en québécois. Aller chanter en anglais aurait été absolument mal perçu.
VM : Quels étaient les liens entre la scène musicale française et québécoise ? Vous intéressiez-vous à ce qui se faisait alors de l’autre côté de l’océan ?
Robert : Ceux qui faisaient de la chanson en France nous intéressaient à coup sûr. On a eu des échanges chaleureux avec Michel Fugain, Julien Clerc, Maxime Le Forestier et on admirait leurs chansons. Véronique Sanson, les productions de Michel Berger, la liste serait longue de nos contemporains français qu’on respectait. Mais il y avait aussi à l’époque un malheureux snobisme à l’égard de la chanson en France, on les jugeait un peu ringards et on se trouvait, nous les Québécois, à l’avant-garde de la chanson francophone. À tort. Arrogance toute adolescente qui nous a heureusement quittés rapidement. Les musiciens et réalisateurs français étaient évidemment souvent fort compétents et on aurait eu beaucoup à apprendre d’eux. Pour le 4e album de Beau Dommage, Passagers, nous avons engagé Thierry Vincent, réalisateur de quelques albums de Julien Clerc. Ses méthodes d’enregistrement nous laissaient fort perplexes. Il nous rassurait en disant: « attendez d’entendre le résultat quand je vais procéder au mixage… » On le croyait à moitié. Quand est venu le temps du mix, effectivement, sa science nous a étonnés. Ce disque sonnait deux fois mieux que tout ce qu’on avait fait auparavant, album pourtant fait ici dans un studio québécois. Et je préfère ne pas penser aux échanges qu’on aurait pu avoir avec des camarades auteurs-compositeurs français et qu’on a snobés par insouciance et arrogance. Il y avait chez eux un savoir-faire d’artisan, une maîtrise de la langue qu’on a ignorés… hélas.
VM : Beau Dommage est l’un des rares groupes de cette période à avoir connu un certain succès en France. Pourquoi est-ce si important pour les musiciens québécois de percer dans l’Hexagone ? Pour élargir son cercle d’admirateurs, ou par soif de reconnaissance hors des frontières du petit pays qu’est le Québec ?
Robert : Pour le plaisir d’aller jouer devant des publics nouveaux. On fait rapidement le tour des 40 salles de spectacle du Québec. Le but premier d’un artiste est de se faire aimer tous les soirs par des admirateurs nouveaux… Pourquoi pas la France ? Votre question est au présent ? Aujourd’hui, l’appât du gain n’est certes pas à dédaigner…
VM : On dit souvent que la musique des années 60 et 70 vieillit mieux que celle des autres décennies. Qu’en pensez-vous ? Pourquoi garderait-elle cette fraîcheur ?
Robert : Toute musique qui est jouée avec des instruments réels et intemporels (piano, guitare, basse, percussions, cordes, etc.) va toujours mieux supporter le passage du temps que les sonorités synthétiques qui séduisent sur le coup par leur nouveauté. Toute chanson qui est composée pour traduire honnêtement une émotion, une pensée qui nous habitent de façon authentique a aussi plus de chance de traverser les époques. Viser le goût du jour pour plaire aux programmateurs radio va peut-être permettre à ta chanson de jouer effectivement sur les ondes, mais elle va se démoder rapidement à cause de son manque de sincérité. Je sais que ça semble cliché ce que je dis. Je sais qu’il y a des exceptions. Mais c’est terriblement et simplement vrai aussi.
VM : Est-ce que Beau Dommage se souciait de la postérité ? Y-a-t-il des choses (un instrument, une voix, un effet technique) que vous refusiez de mettre dans votre musique afin de ne pas trop la dater et, par conséquent, qu’elle se démode plus vite ?
Robert : Non.
VM : Voilà, c’est fini. Merci, Monsieur Léger. Le moment est idéal pour aller prendre un peu de soleil.
Robert : Tout le plaisir fut pour moi. Les questions étaient neuves. C’est un bonheur que l’on rencontre rarement au fil des entrevues.
Béatrice et Francis
////